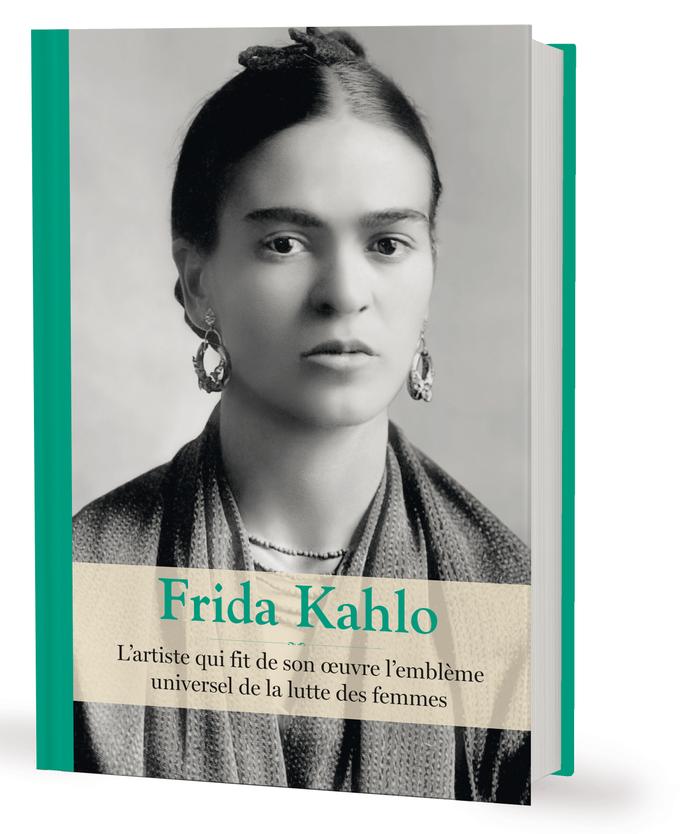Ce livre passionnant reprend les lettres relatives aux voyages de Vespucci, à ses découvertes, envoyées essentiellement de Séville où il résidait en sa qualité de responsable des affrêtements de bateaux pour le Nouveau Monde, en tant que spécialiste des cartographies, ou de Lisbonne où il répondait aux demandes des rois manuélins comme pilote de navire, à la famille Médicis, à Florence, d’où il était originaire.
Son livre appelé Le Nouveau Monde intègre aussi des lettres sur les îles nouvellement découvertes en ses quatre voyages.
Vespucci a vécu, à son corps défendant, des controverses qui l’ont opposé à Christophe Colomb alors qu’ils se respectaient, se considéraient même comme amis, ayant à peu près le même âge, né en 1451 sans certitude pour Colomb à Gênes, né en 1454 de manière certaine pour Vespucci à Florence, Ligure et Toscane se touchant.
Amerigo a connu dans sa jeunesse florentine le géographe Toscanelli dont la célèbre carte du monde fut la référence de Colomb avant son premier voyage.
Il fut aussi présent lors du retour à Barcelone de Colomb, de son premier voyage ; à partir de ce jour de liesse il a entretenu des rapports d’estime avec celui qui fut célébré comme Amiral de la mer Océane.
Amerigo fut contesté par les historiens de périodes ultérieures sur la réalité de ses quatre voyages, mais de nombreux spécialistes garantissent leur authenticité.
Vespucci ne peut en aucun cas se voir accusé de vanité pour avoir trafiqué certains de ses textes pour ravir à Colomb la gloire de la première découverte des terres du continent américain.
Aucune duplicité ne se repérait dans les relations entre les deux navigateurs, qui ne se sont nullement détériorées avec la publication par Vespucci du Nouveau Monde que Colomb ne pouvait pas ne pas avoir lu.
Colomb a même adressé une lettre à Diego, le fils de Vespucci, à la suite d’une visite qu’Amerigo lui avait rendue, montrant ainsi l’intensité et le respect de leurs échanges communs.
Mais Vespucci était au service de Ferdinand d’Aragon qui trouvait que Colomb se voyait bien trop exigeant, qui a fini par s’écarter de lui, lui préférant le plus révérencieux, modeste Vespucci, ce qui entraîna par la suite de nombreux commentaires souvent peu avisés…
Vespucci a intégré un premier voyage en 1497 du fait de ses qualités émérites d’astronome, de cosmographe puisque les bateaux se guidaient à cette époque par les astres, l’observation des étoiles.
Vespucci partit de Cadix puis se rendit aux Canaries avant d’arriver en terre ferme sur les côtes de l’actuel Honduras, qu’il pénétra, comme il se rendit ensuite au Venezuela actuel puisqu’il y décrit des maisons construites dans les arbres ou sur pilotis comme cela se déroulait à Maracaibo à pareille époque.
Le retour se déroula en longeant l’actuelle Virginie, puis reprenant le chemin d’Haïti et des Bermudes.
Vespucci montre une description très précise des iguanes rencontrées qu’il nomme dragons.
Ce premier voyage dura dix-sept mois.
Son second voyage se déroula de mai 1499 à septembre 1500, le navire à bord duquel Vespucci touche le Brésil remonte ses côtes pour atteindre l’embouchure de l’Amazone, puis met le cap à proximité de la Guyane et de l’île actuelle de Curaçao.
Pour le troisième voyage de mai 1501 à septembre 1502, le plus connu et le plus important, commanditée par Manuel Ier du Portugal, il séjourna au Brésil près d’un mois et prolongea sa route vers le sud, atteignant le 50ème degré sud, voguant sans cesse sans raconter de terre ferme jusqu’à Rio de La Plata, en actuel Uruguay, l’amenant à considérer avec justesse la constatation de terres nouvelles ignorées des anciens.
Cette nouvelle image géographique est esquissée, ébauchant la découverte d’un continent distinct qui sera reprise dans la nouvelle planche de l’atlas de Ptolémée, dans celles des prieurés vosgiens (gymnases) dits de Waldseemüller à Saint-Dié, qui pour la première fois, en 1507, mentionnent cette partie entre Brésil et Rio de la Plata, légitimement, terre d’Amerigo, terre d’Americ, première marque retenue de la mention Amérique.
Vespucci se voit obligé de rebrousser chemin en retournant au Portugal car les navires du chef d’expédition qui s’étaient séparés pour scruter de nombreuses terres n’ont pu se rassembler comme prévu.
Un dernier voyage moins renseigné s’est tenu entre juin 1505 et septembre 1506 en direction des Moluques.
Vespucci est nommé premier pilote (« piloto mayor ») chargé d’établir les cartes nautiques destinées aux futures expéditions du Nouveau Monde et il fut le premier à occuper ce poste prestigieux en devenant naturalisé espagnol sur Séville.
Il meurt en 1511, certainement touché par l’épidémie de peste qui s’étend en Espagne en cette même période.
Le « gymnase vosgien », qui a inscrit le nom d’Amerigo en hommage aux terres recensées, précise clairement qu’Amerigo constitue à la fois un découvreur et un homme remarquable, que son nom complète harmonieusement les noms existants des autres parties du monde connu, que ce sont surtout ses écrits qui ont fait le mieux connaître les terres nouvelles aux habitants.
Comme l’a écrit le grand écrivain autrichien Stefan Zweig « ce n’est pas par la volonté d’un être humain que ce nom très mortel a franchi le seuil de l’immortalité, le destin l’a voulu qui a toujours raison. ».
Vespucci souligne la beauté plastique des personnes qu’il rencontre, permettant de donner une image plus flatteuse des « sauvages » en comparaison avec celles transmises par les pères pèlerins qui accompagnaient Colomb.
Il est émerveillé par leurs aptitudes à la course, à la nage, il envie le fait qu’ils soient en permanence libres, agissant comme étant leurs propres maîtres.
Il est plus en retrait sur les mœurs sexuelles sans pudeur ou autocensure, ou sur le vécu permanent en nudité crue.
Il insiste cependant sur le fait que les femmes n’ont pas de seins pendants, y compris après de multiples grossesses.
Il remarque que les femmes sont infériorisées mais qu’elles savent utiliser des artifices pour conquérir les hommes qu’elles convoitent.
Il observe aussi qu’elles peuvent se servir d’arcs agrémentant le mythe des femmes guerrières.
Vespucci fait preuve d’une ouverture d’esprit remarquable, d’une compréhension des coutumes des autres proche des humanismes comme Montaigne.
Vespucci est aussi le premier européen à décrire et analyser l’anthropophagie des Indiens du Nouveau Monde, il reste interdit quand ces derniers s’étonnent que les navires venant d’ailleurs racontent qu’ils ne mangent pas leurs ennemis vaincus…
Vespucci s’intéressait pour ses commanditaires par les richesses et bénéfices des voyages auxquels il a contribué, mais la soif de l’or n’était en aucun cas pour lui une obsession.
Il vous faut lire ce témoignage vivant et documenté sur les côtes d’un continent qui porte son nom dont il a fermement pressenti l’existence, constituant ainsi un texte fondateur par ses précisions fortes naturalistes et cartographiées.
Éric
Blog Débredinages
Le Nouveau Monde (1504)
Les quatre voyages d’Amerigo Vespucci
Traduction (italien florentin), introduction et notes de Jean-Paul Duviols
Chandeigne Éditions